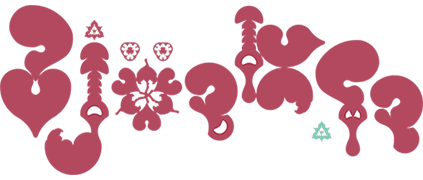Numéro : Depuis trente ans, dans chaque nouvel album vous transposez des histoires, thématiques et des émotions nouvelles en instruments, en mélodies et en images. Comment procédez-vous ?
Björk : Dans la carrière d’un musicien, il y a toujours ce moment où l’on rentre de tournée, exténué d’avoir joué les mêmes morceaux pendant des mois avec le sentiment d’être allé au bout de ce qu’on voulait transmettre. Il est suivi d’un temps de latence – qui dure entre un et deux ans chez moi –, où l’on ignore ce que l’on va faire après. C’est là que je me sens la plus libre. Je fais appel à ma part adolescente pour repérer les premiers indices qui m’aideront à résoudre l’énigme qui sommeille en moi. Cela peut passer par une couleur précise, une playlist que je viens de créer. Au fur et à mesure, j’ajoute de nouveaux éléments en suivant cet instinct. Puis, bien plus tard, je délaisse l’“adolescente” pour appeler l’“éditrice” qui vient épurer le tout.
Est-ce pour cela que chacun de vos albums est si différent du précédent ?
Pour moi, l’écriture musicale est très similaire à l’amitié. Avec un ami d’enfance, on s’ennuie très vite si on a toujours les mêmes conversations qu’il y a quarante ans. Les bonnes amitiés, ce sont celles où les échanges se renouvellent et s’enrichissent à mesure que l’on évolue. Quand j’écris une chanson qui me semble trop proche d’un ancien morceau, c’est qu’elle ne vaut pas la peine d’être sortie. Il existe déjà suffisamment de chansons de Björk pour ne pas sortir des titres qui ressemblent à ce que j’ai déjà fait ou à tout le fatras qu’on trouve sur Internet – que j’adore explorer par ailleurs. Mes albums ont beau être tous très différents, ils sont liés par une même colonne vertébrale : ma voix, évidemment, ainsi qu’un mélange de sonorités électroniques et acoustiques... C’est comme se regarder dans le miroir quand on se brosse les dents : tous les matins, on retrouve les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. J’aime beaucoup cette idée de composer avec ce que j’ai autant que de pouvoir modifier ce qu’il y a autour, comme j’adore changer constamment de vêtements.
Dans votre nouvel album, Fossora, ce sont cette fois les champignons qui, des images aux paroles, émergent comme un thème majeur. Pourquoi vous fascinent-ils autant ?
Les champignons parlent de notre système neurologique. De guérison aussi. Leur apparence, leur énergie, leur manière de croître et de se développer est passionnante, et on peut d’ailleurs la ressentir dans les beats de mon album. Aujourd’hui nous découvrons tellement de choses à leur sujet : à Tchernobyl ou dans d’autres lieux dévastés par des accidents nucléaires, ce sont les champignons qui réapparaissent avant tout le reste ! Face à la crise environnementale que nous traversons, je place beaucoup d’espoir dans les champignons, et nous gagnerions vraiment à écouter ceux qui travaillent sur ce sujet.
La question de la famille est également très présente dans cet album. Dans deux morceaux, chantés en duo respectivement avec votre fils et votre fille, vous rendez hommage à votre mère décédée il y a cinq ans. Cet album est-il une célébration de vos origines ?
Le personnage de Fossora est né quand j’inhumais ma mère. Il n’est pas une réponse directe à cet événement, mais je pense que toute personne qui a perdu un parent peut comprendre ce besoin, pendant le deuil, de creuser dans son passé à la recherche de ses ancêtres et de se repositionner dans l’arbre généalogique. Alors que mon précédent album parlait d’évasion, de quitter le quotidien et le cadre familial, ce nouvel opus m’a plutôt permis, lui, de creuser dans le sol pour retrouver mes racines. Il n’évoque pas tant mon rapport à l’Islande que l’impossibilité de voyager et d’autres circonstances qui nous conduisent à plonger au fond de nous-mêmes. J’aurais pu l’écrire n’importe où, tant que je m’y sentais chez moi.
À propos de “chez soi”, après avoir vécu partiellement à Londres dans les années 90, puis New York pendant des années, vous êtes en effet revenue définitivement à Reykjavík, où vous résidez désormais toute l’année. La pandémie vous a d’ailleurs imposée de rester dans votre pays sur une longue durée. Vous y sentez-vous toujours aussi bien ?
Quand je vivais à Londres ou à Brooklyn, ces villes restaient mes deuxièmes maisons, puisque j’habitais quand même en Islande au moins la moitié de l’année. J’adore vivre ici, et j’étais ravie lorsque le confinement est arrivé et que je n’avais pas à quitter mon pays pendant deux ans. Même ne plus aller à l’aéroport était fantastique ! Nous n’avions pas beaucoup de restrictions donc notre mode de vie n’a pas beaucoup changé, nous pouvions toujours aller à la plage par exemple. Aujourd’hui, je dirais que l’Islande me permet de rester humble. Plus égoïstement, j’apprécie que vivre dans une ville de la taille de Reykjavík rende les choses si simples. Quand je veux aller voir un concert, j’en ai pour cinq minutes de trajet. Quand je veux avoir une discussion philosophique avec un ami, je peux lui écrire et le retrouver dix minutes après dans un café, ou marcher quelques minutes de chez moi pour aller voir le nouveau Star Wars. Cette proximité et la météo du pays nous invitent à être très spontanés, d’ailleurs nous n’organisons pas vraiment les choses en amont. Si vous demandez à un Islandais “tu serais disponible pour venir dîner la maison la semaine prochaine ?”, il vous regardera comme si vous étiez fou, comme moi lorsque je parlais avec des Londoniens ou des New-Yorkais ! (rires). Vivre ici aujourd’hui ne me donne pas du tout l’impression de sacrifier ce que j’aurais pu faire dans une plus grande ville. C’est d’ailleurs l’inverse, maintenant que de nombreux concerts, pièces de théâtre, expositions, films et festivals viennent à nous, ce qui n’était pas le cas quand j’avais vingt ans.
En 2015, dans votre album Vulnicura, vous apparaissiez extrêmement vulnérable, brisée par votre séparation. Sept ans plus tard, vous semblez à nouveau vous mettre à nu, mais de façon bien plus contrôlée cette fois. Écrire Fossora vous a-t-il permis de reprendre le pouvoir sur vous-même ?
Je pense, oui. Dans ma musique, je cherche à documenter les différents états que nous traversons en tant qu’êtres humains, qu’on le veuille ou non. Ce que j’ai vécu avant Vulnicura n’était pas un choix, mais un traumatisme provoqué par cette situation inattendue qui m’a laissée complètement sans protection. L’album Utopia est venu logiquement ensuite, comme une échappée nécessaire dans les airs. Enfin, dans Fossora, je reviens à moi-même selon mes propres termes. Le fait de rester dans mon nid pendant ces trois dernières années, entourée de mes proches, m’a permis de m’y livrer de façon beaucoup plus maîtrisée et sereine.
Vous avez dit un jour que lorsque vous écriviez vos morceaux, la mélodie venait souvent avant les paroles. Avec les paroles de Fossora, très personnelles notamment au sujet de votre famille, est-ce que cela a changé ?
Cela varie. En général, les mélodies viennent effectivement d’abord, et si je suis chanceuse, elles arrivent en même temps que les paroles. La plupart du temps c’est comme un puzzle que je devrais assembler au fur et à mesure. Pour un morceau comme Unravel, sur l’album Homogenic [1997], j’avais écrit les paroles dans mon journal et j’ai mis plusieurs années avant de trouver la mélodie qui correspondait. Pour mon morceau Jóga, du même opus, c’était l’inverse : la mélodie trottait dans ma tête depuis deux ans avant que le trouve les mots du refrain. Donc encore plus pour Fossora, que j’ai mis cinq ans à écrire, chaque morceau a été écrit d’une manière différente.
Plusieurs morceaux de cet opus, comme son premier single Atopos, se terminent par des beats gabber [genre de techno hard-core] frénétiques qui surviennent de façon très soudaine. D’où est venue cette construction étonnante ?
J’imaginais une sorte de “fête Covid” où l’on serait tranquille chez l’un de nos amis, à dix maximum, à cause des restrictions. D’un coup, tous les gens se lèveraient pour danser comme des fous pendant une minute avant de se rasseoir, puis chacun rentrerait chez soi tôt pour respecter le couvre-feu. Cela a donné lieu à cette structure rythmique qui, pour moi, est une touche humoristique et une manière de me moquer de moi-même. Lorsque j’écrivais l’album, j’écoutais beaucoup de clarinette, de gabber et de musique d’Afrique de l’Est. Initialement, j’avais prévu de travailler avec Arca, comme pour les deux précédents opus, mais la pandémie m’a empêchée d’aller la voir à Barcelone ou de l’accueillir chez moi. Puisque j’avais ces cinq années devant moi, dont trois sans pouvoir voyager, j’ai donc commencé à écrire ces morceaux qui débutent par un rythme très lent avant de s’accélérer soudainement à la fin, grâce à l’intervention du duo Gabber Modus Operandi.
Au fil de votre carrière, vous avez en effet collaboré avec des artistes d’horizons très différents, de la chanteuse inuite Tanya Tagaq au producteur hip-hop Timbaland. Comment réussissez-vous à intégrer toutes ces personnalités très fortes dans votre univers ?
J’aime beaucoup cette étape, justement. Je consacre tellement de temps à travailler seule qu’après trois ans passés dans mon coin à écrire les paroles, les mélodies et les arrangements, je me suis dis : “Allez, c’est enfin le moment d’organiser une fête et d’inviter du monde !” Plus j’avance dans ma carrière, plus je mets du temps à inviter d’autres artistes sur mon projet, ce qui me permet de leur exposer clairement mes intentions, tout en sachant quelle part de liberté ils peuvent prendre pour apporter leur patte. Pour cet album, les collaborations sont arrivées seulement trois mois avant la fin. J’écoutais certains morceaux en me disant qu’on pouvait faire mieux. J’ai donc écrit à Kasimyn [moitié du duo Gabber Modus Operandi] : “Je viens d’écrire cet étrange album très ‘terreux’, plein de clarinettes basses, et j’ai programmé des beats gabber sur certains morceaux. Tu pourrais en faire quelque chose ?” L’univers de Fossora lui a beaucoup parlé. Depuis Bali, il m’a envoyé dix beats, j’en ai intégré à mes titres, les lui ai renvoyés, et il était ravi.
Depuis votre premier album en 1993, vous avez sorti des dizaines de remix de vos morceaux, et vous venez de dévoiler un remix de votre single Ovule par Sega Bodega et Shygirl. Les remix sont-ils une autre manière de retrouver l’esprit festif dont vous parlez ?
Lorsqu’il réalise un album, chaque musicien est contraint à un moment de se tenir à une version d’un morceau en sachant que celle-ci ne bougera plus. Nous devons donc choisir celle qui nous semble la meilleure mais aussi celle qui pourra supporter de nombreuses écoutes. Les remix, c’est l’inverse. Lorsque l’on est très discipliné en finalisant l’album, donner l’opportunité à un autre artiste de le réinterpréter est très libérateur, car le vrai et le faux n’entrent plus en compte. Cela me rappelle le jazz des années 50, ou l’on pouvait avoir des dizaines de versions d’une même chanson comme My Funny Valentine : de la même manière, on avait une base commune et un espace de liberté, dans lequel on pouvait faire ce qu’on voulait. Inviter d’autres artistes à remixer mes morceaux est aussi une manière excitante de les rencontrer à travers le prisme de la musique. J’avais déjà rencontré Sega Bodega et Shygirl mais je ne les connaissais pas très bien, et leur remix d’Ovule a emmené le morceau dans une toute autre direction. J’ai également remixé un morceau de l’album de Shygirl, Woe, qui sortira prochainement. Aux questions qu’elle pose dans ses paroles, j’ai répondu par des mélodies que j’ai moi-même chantées, comme une amie qui viendrait éclaircir ses doutes.
On vous voit ici clairement quitter le paradis sucré et céleste illustré par votre précédent album Utopia (2017) pour descendre sous la surface de la terre avec Fossora – néologisme qui, pour vous, signifie d’ailleurs “la fouisseuse”. Ces deux opus forment-ils un yin et un yang ?
Complètement. Je sais que mon travail ne le montre pas vraiment, mais je suis quelqu’un de très terre à terre et pragmatique. Je ne pouvais écrire un album aussi idéaliste qu’Utopia qu’en sachant que le suivant rééquilibrerait le tout. En somme, mon album précédent parlait de la vie que je souhaitais idéalement, et celui-ci de comment la vivre réellement. Je suis justement en pleine intégration des vidéos de Fossora dans mon spectacle Cornucopia, créé en 2019, que je présenterai en Europe à l’automne. C’est, à ce jour, mon projet le plus cher, extravagant et théâtral, ce qui justifie d’autant plus d’y ajouter un deuxième album. J’ai d’ailleurs vraiment hâte de remplacer mes morceaux à base de flûte et de chants d’oiseaux par des clarinettes et du gabber.
Dans votre podcast Sonic Symbolism, sorti en août dernier, vous décrivez chacun de vos précédents albums comme un personnage de tarot. Pouvez-vous décrire le personnage de Fossora aujourd’hui ?
J’ai sans doute l’air d’une petite fille très consciente de ce que je fais dans le podcast, mais c’est tout l’opposé quand je compose. Ce n’est que trois ans environ après avoir sorti un album que j’arrive à analyser ce dont il parle et pourquoi je l’ai réalisé ainsi. À ce stade, il est encore trop tôt pour que je puisse parler de Fossora comme cette petite fille du podcast, en particulier tant que je ne l’aurai pas interprété sur scène. Je peux seulement vous dire que c’est un personnage qui s’enracine dans la terre, qui se satisfait de ce qu’il a, sans en vouloir plus. J’y vois comme couleurs dominantes le vert foncé, le brun et le bordeaux... Redemandez-moi dans cinq ans, je pourrai vous en parler plus clairement !
Vous fêtez cette année vos trente ans de carrière solo depuis la sortie de votre premier album, Debut. En 2004, vous déclariez que votre meilleur album était encore loin devant vous. Est-ce toujours le cas ?
Aujourd’hui, je ne pense plus qu’un de mes albums soit meilleur qu’un autre. Que j’aie 20 ou 100 ans, qu’il y ait sept ou sept millions de personnes qui m’écoutent, ce qui compte c’est que j’accorde toujours la même importance à chacun de mes morceaux. Ma tournée Cornucopia est sans doute le projet le plus extravagant que je ferai de toute ma vie, ce qui ne veut pas dire que ce soit mon meilleur. Aussi terrifiante qu’elle puisse être, l’angoisse de la page blanche que l’on ressent avant chaque nouveau projet est cruciale. Ce que je ferai plus tard, finalement, je n’en sais rien et je ne veux pas le savoir. Sinon, créer deviendrait bien ennuyeux !