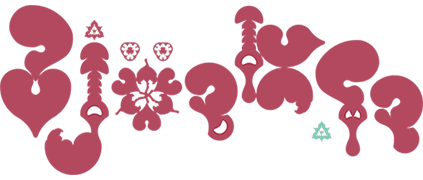L’ex-punkette islandaise, devenue icône absolue, n’en finit plus de former de nouveaux mondes musicaux dans un sixième album ardu et envoûtant. Elfe exubérante et princesse introvertie, artiste spontanée autant que cérébrale, femme-enfant deux fois mère, elle reste une insaisissable étincelle glacée. Bienvenue dans la galaxie Björk.
Rencontrer Björk est un piège. Devant sa taille d’elfe, ses mines de chat, ses gazouillis de moineau, on perd de vue que cette charmante enfant bientôt quadragénaire est une force de la nature. Apprécions la faveur du jour : passer avec elle le temps que dure son nouvel album, Medúlla. Mais questionner Björk fait oublier pareillement que la part d’elle qu’on voudrait mettre au jour est insondable, et le restera. Björk est là pour parler de cette chose qui se traduit « Moelle », qu’elle déclare faite de sang, de muscle et d’un peu de terre. Elle veut bien en développer l’idée, en détailler la réalisation, « défendre », en somme, son nouveau bébé de son, dont elle lie curieusement le sort au bébé de chair qui le précéda d’un an et demi : son deuxième enfant, seize ans après le premier, l’investissait de la surpuissance de mère Nature. D’où confiance, autonomie et lâcher de vocalises à l’air libre. Il y a pourtant fort à parier que Medúlla ne sera pas attaqué. Les rétifs à sa voix seront d’office refroidis par un disque où les instruments brillent par leur absence. Les fervents jubileront de cette nouvelle audace. Puis d’autres iront à Björk en cortège mou, comme à l’une de ces messes post-modernes où la foule est virtuelle, assemblée par le simple achat d’un objet de culture. Quitte à remiser le fétiche éphémère au bout d’une écoute, par manque de temps, de patience ou d’envie - c’est ainsi, c’est humain.
Dans sa folle jeunesse islandaise, Björk, un jour, monta, avec quelques excités de son genre, un collectif nommé Bad Taste. Ses attentats ludico-terroristes (assaut d’une chaîne télé, festival de films X, messages pirates sur le mode « fuck the system », port de vêtements roses en réaction au punk) revendiquaient le mauvais goût. Vingt ans après, Björk aurait toutes chances d’être élue miss Good Taste, incarnation même du bon goût néopop international. Bon goût de ses choix artistiques et de la conduite de sa carrière. Bon goût de ses auditeurs, flatté par d’incessants efforts pour renou- veler image et son. Björk a le don rare de se dévoiler d’album en album, sans jamais nous ôter l’impression que sa « nature » est un autre déguisement. Celui aussi, plus rare encore, d’englober tout ce qui vibre autour d’elle et de sa musique. Sommée de définir celle-ci, à l’époque de son premier album (Debut, 1993), elle lâchait la formule « Björk music ». Ça faisait mégalo, c’était parfaitement sincère, et c’est toujours valable.
Il y a une musique Björk, à nulle autre comparable. Il y a même, au-delà, un monde Björk (ou un univers, une planète Björk, si l’on poursuit l’élan cosmique). Y habitent, transitent ou gravitent celles et ceux qui ont été pris ne serait-ce qu’une fois dans les cercles où s’exerce le magnétisme hors du commun de la fée Björk, transie d’électricité. Collaboration, croisement, admiration, tout avec elle fait feu ou étincelle. Certains noms de musiciens, producteurs ou réalisateurs de clips (Graham Massey, Marius de Vries, Mark Bell, Chris Cunningham) ne nous sont devenus familiers que par cette étrange citoyenneté. Les noms inconnus du générique de Medúlla (Tagaq, Rahzel, qui fait des beats avec sa bouche, Mike Patton, voix de la formation death metal Fantomas) sont peut-être des mots de passe de demain. D’autres existent par ailleurs, mais l’étiquette Björk est bien en vue sur leur valise. Les films les plus diffusés de Spike Jonze ou de Michel Gondry sont, jusqu’à présent, des clips de Björk.
Même la reine Madonna a un jour fait allégeance, en commandant un titre à princesse Björk pour son album Bedtime Stories. Là où on serait tenté de chercher l’irrationnel à tous les étages, Björk ne cesse de vanter la valeur du travail. Comme Madonna, c’est une bosseuse acharnée. Pas tout à fait dans la même branche : la Ciccone avait besoin de la musique, et non l’inverse. Elle est venue en un temps, le début des années 80, où une star féminine de la chanson rythmée devait encore se bagarrer pour les pleins pouvoirs. Madonna a consacré beaucoup d’énergie à s’imposer en grande soeur délurée de l’Amérique puritaine et du monde. A Björk, émergeant, dix ans après, des cendres d’un groupe new wave anecdotique (les Sykurmolar, anglicisés en Sugarcubes), revenait le rôle de la petite soeur excentrique - et givrée, elle, de musique depuis le berceau. Fille-chanteuse au pays d’un show-biz de garçons, elle a eu la chance et le culot réunis de ne pas se poser de question.
Dans les années 70, Patti Smith, l’Isabelle Eberhardt du rock, avait dû se déguiser en mec pour gagner l’estime générale. Désormais, Björk pouvait passer n’importe quel costume, elle était bienvenue dans un club où, d’ailleurs, le mot « rock » n’avait plus tellement cours : le rap l’avait mis cul par-dessus tête, et Kurt Cobain al- lait mourir de ne pas supporter ce qu’était devenue sa gloire. Björk, fille de hippie, était vaccinée contre les chimères, pas contre l’ambition. Que celle-ci se cache derrière une modestie de fillette en peluche venue d’ailleurs la rendait plus séduisante encore. Elle rougissait de voir les « petites excentricités » rassemblées sur son album Debut comme on fait des collages dans un journal intime s’écouler par caisses et susciter partout l’éloge. Avec ses montagnes russes en Playmobil, semées d’anglais guttural et de syllabes aspirées, Björk rafraîchissait, bousculait, réchauffait. Elle était joliment bizarre, exotique, mais d’un exotisme inédit, ce- lui du nord des isbas, des sagas. Elle eut beau s’installer à Londres et finir par hurler que son Islande natale n’avait rien à voir avec les Eskimos, rien n’y faisait. Elle serait pour toujours mascotte autant que musicienne.
Björk était fille, elle était aussi mère d’un garçon qu’elle trimballait déjà en tournée au temps des Sugarcubes. Elle était encore lutin, troll, animal ; elle était minérale et végétale ; elle était en granit, en racines, en feuilles ; elle était en bois, en fourrure, en plastique, en acier ; elle était un corps immatériel avec une voix qui ne cesse d’en sortir. Son sexe alors n’était plus celui d’une jeune femme moderne, mais celui, immémorial, des sortilèges de la noire forêt des contes ; ou celui, programmé, d’une Eve future bionique à la blancheur effrayante. Cette Björk à la fois bio et techno ne pouvait tomber plus en phase avec son époque. Chacune de ses métamorphoses serait une surprise et une confirmation. On garantit ce trouble à qui voudra contempler les vingt et un reflets de l’artiste et créature dans le miroir de ses clips compilés en DVD. On y voit Björk en ménagère-enfant, en Alice au pays des gratte-ciel, en harpie sous liquette, en meneuse de revue pour rire, en hybride ours polaire, en île volcanique, en robot, en visage nu aux orifices parcouru de fluides, en foetus... Et chaque fois une version différente du cri primal, plus ou moins orchestré, habillé, mixé, ponctue cette perpétuelle naissance.
On sait tout de Björk. Ce n’est pas compliqué, il suffit d’aller sur son site officiel. On y apprend qu’avant de passer à Medúlla, elle a conçu le coffret Family Tree comme un nettoyage de printemps, une forme de bilan. Que le précédent, Vespertine (2001), était un album hivernal. Qu’elle trouvait celui d’avant, Homogenic (1997), cinq fois meilleur que Debut. Qu’elle considérait Post (1995) comme un album de duos avec ses sept collaborateurs. Que ses associations professionnelles ont souvent été des partenariats amoureux. Qu’elle est copine avec PJ Harvey, Thom Yorke de Radiohead, RZA du Wu-Tang Clan. Qu’elle admire Prince et Joni Mitchell, qui l’admirent en retour. Qu’elle préfère Ella Fitzgerald à Billie Holiday. Qu’elle possède des poumons plus gros que la moyenne. Qu’elle n’a jamais eu d’idole. Qu’elle a perdu sa voix après la tournée Post. Qu’elle s’est soignée par l’acupuncture. Qu’elle a vécu à New York, en Espagne. Qu’elle a pratiqué le karaté et le kung-fu. Que les féministes l’ennuient. Qu’elle s’ennuie facilement. Qu’elle s’est passionnée à 17 ans pour Histoire de l’oeil, de Georges Bataille, au point de vouloir le faire lire à tout le monde. Qu’elle collectionne les bateaux. Qu’elle s’est rasé les cheveux dès l’âge de 12 ans, avant de les porter longs et orange. Qu’elle vomit la tiédeur et le rock à guitare. Que ses parents se sont séparés quand elle avait 2 ans. Que dès l’âge de 1 an, la belle musique lui donnait la chair de poule.
Et mille autres choses encore. Voici Björk bientôt née sous nos yeux. Chaque nouvelle interview, consentie aujourd’hui au compte-gouttes mais sans que le débit se tarisse, ajoute une pièce au puzzle indéfini- ment recomposé. Récemment, elle a réécouté tous les concerts enregistrés au long de sa carrière. Elle n’y entendait que les erreurs, les dérapages, les manques. Elle se sentait prête à voyager vers ses 18 ans, quand sa voix se dessina vraiment ; à réécouter Meredith Monk, des disques de yodel et Billy MacKenzie, le ténor écossais des Associates. On note cela scrupuleusement. Puis on lui lâche délibérément Sinatra, qui ne lui fait ni chaud ni froid, pour mieux l’entendre flûter les louanges de Chet Baker, le trompettiste croonant au filet suave, un maître de l’oxygène, selon sa formule à elle. Björk aime les artistes généreux, non ceux préoccupés de pouvoir. Les vocalistes doivent être docteurs ou infirmières, on doit se sentir différent après traitement. Formule encore.
Plus la « vraie » Björk semble se livrer entière, plus on est tenté à l’inverse de décomposer la Björk de synthèse, la seule qui nous soit vraiment connue. Ainsi sont faites les étoiles, d’un compost où s’agglomèrent les traces, inaperçues parfois, qui les ont précédées et les signes du temps qu’elles paraissent cristalliser comme par magie. Björk avant Björk, c’est cent incarnations fugaces. Janis Joplin trépignant de rage sur la scène de Monterey. Judy Garland en Dorothy, les mains en corolle autour du visage. Rickie Lee Jones dépoussiérant des standards (My funny Valentine, Walk away Renée) avec son feulement feutré de vieille petite fille. Lene Lovich (la cousine météorique de Nina Hagen) poussant des hululements de Vampirella sur fond de hoquets new wave. Joni Mitchell glissant, digne et noire, sur la banquise de son chef-d’oeuvre, Hejira. David Bowie en pierrot lunaire, face plâtrée, traversant au ralenti le clip d’Ashes to ashes. Yma Sumac inventant brièvement le concept de diva vaudoue. Et caetera, et caetera. Pas de ces influences avérées qui vous coupent le sifflet (longtemps Björk servit du Stockhausen aux rédacteurs ébahis), mais des incidences cachées.
Quant à Björk en dehors de Björk, ce sont des flashs nets ou flous pris au fil de la bande-image et son des douze dernières années. La mania des mangas, et tout ce qui s’ensuit de régression transmutée par le graphisme. Les films de Luc Besson, dont l’un, Léon, kidnappa une chanson de Björk. Tel défilé de Gaultier, Lacroix ou Van Notten. La saga trilogique enfin filmée du Seigneur des anneaux, et son déluge de lutins bouclés. Tout un déferlement de chanteuses à cri, de la crispante des Cranberries à de plus mesurées scandinaves (Stina Nordenstam). Telle photo de Michael Jackson, où l’on se demande s’il n’a pas montré Björk pour modèle à son chirurgien. La pugnacité transsexe des nouvelles starlettes électros (Peaches, Ellen Alien), comme des mamas rappeuses (Missy Elliott). Et caetera, et caetera. Monstre de discipline, Björk est la déesse de ce désordre. On s’égare là où elle règne. On perd pied quand sa musique ne cesse de tenir tête.
On avait cru négliger Vespertine, et son duvet soyeux, crépitant de battements d’ailes de mouche, qui tapissait un coin d’oreille. Les premières écoutes de Medúlla sont discordantes, elles dénoncent l’arnaque au concept (on ne peut pas le dire strictement a cappella), annoncent la répétition du même dans un nouveau dénuement, puis, sans crier gare, jettent leurs sorts ici et là. Balise inespérée, la voix de Robert Wyatt (le duo Submarine) vient nous éclairer. Björk est allée sonner le vénérable, à sa manière, sans chichis. Il lui a offert le gîte, le micro, le couvert et quelques bonnes bouteilles. Et hop ! du premier jet, c’était dans la boîte à coucou. Cela ne veut pas dire que la visiteuse était fan. Elle ne connaissait pas Rock Bottom. Il y a trente ans, la voix de Wyatt, très jeune ancêtre, explorait des profondeurs inouïes, déjà sous-marines (intra-utérines ?), en donnant l’impression à l’auditeur sidéré de les découvrir en même temps que lui (1). Une extase encore douloureuse mais enfin paisible concluait le glissement tourmenté d’un corps qui cherche à tout moment sa respiration. Depuis, l’homme à barbe blanche a fait de plus sages voyages, mais en gardant toujours ce nadir en tête.
A l’opposé, Björk paraît viser obstinément vers le haut. Chasseresse de quelque dahu musical des origines, elle ne cesse de lancer des flèches. Elle semble les arracher à sa propre chair, et c’est ce qui force ici le respect ou l’admiration, là, le simple réflexe d’écouter. Elle fait comme une sauteuse qui n’en finit pas de prendre son élan, ce qui a le don d’irriter aussi, de dé- courager parfois. Mais il arrive que naisse de ces poussées laborieuses une mélodie brusquement irradiante, c’est l’innocence perverse de Venus as a boy, l’hymne épanoui de Joga, le décollage vertical de I’ve seen it all sur la scène du train de Dancer in the dark. Son meilleur clip est peut-être ce passage du film de Lars von Trier, qui parvint à saisir sa texture paysanne et un peu d’abandon qui pour une fois lui échappait. Björk s’empressa de récupérer le butin, maquillant la BO du film en son propre Selmasongs. Le grand huit, la nuée crevée, c’est encore - on peut le trouver en cherchant bien - ce vieux chant de son pays qu’elle interprète dans le presque anonymat d’une compilation (Chansons des mers froides, 1994). Björk s’en souvient, tout en déplorant la sauce trop new age qu’on aurait liée dans son dos. Sur Medúlla, Björk chante un peu en islandais, fascine, énerve, et finalement fait le boulot. Elle ne nous a pas parlé cette fois-ci de la chanson parfaite, celle qu’elle espérait écrire dans les cinquante ans qui viennent. C’était il y a quelques années. Nous saurons être patients. Björk a tout pour faire un monde, et ce monde sait se faire accueillant. Que lui manque-t-il alors ? Pas la force, ni l’instinct, ni la ruse. Une certaine légèreté, peut-être. On veut bien croire qu’elle y travaille.
(1) On recommande la version de Sea Song, des fameuses Peel sessions, sur un CD récent compilant des inédits et des raretés de Wyatt, Solar flares burn for you (Cuneiform Records).