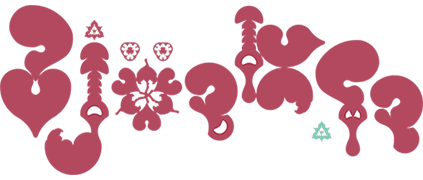Revenir en Islande, c’est vous ressourcer au plus près de la nature ?
J’ai vécu ici jusqu’à l’âge de 27 ans. J’y passe encore la moitié de mon temps. Pour moi, cette vie proche de la nature est la norme. C’est la vie urbaine qui est une évasion, quelque chose d’exotique comme peut l’être Disneyland. Qui aurait envie de vivre là tous les jours ? La civilisation occidentale tend à penser que vivre proche de la nature est un fantasme, une utopie. Je pense le contraire. Une partie de ma famille mange d’ailleurs ce qu’elle pêche, cueille et chasse.
Dans une chanson comme Vertebrae By Vertebrae, vous mettez en scène une nature qui prend sa revanche ?
Dans beaucoup de films d’épouvante américains, la nature est l’ennemie. J’ai imaginé une bande-son de série B dans laquelle « mère nature » reviendrait tel un zombie après quatre mille ans de sommeil, rescapée des religions qui ont cherché à l’annihiler, à nous séparer d’elle.
Ma petite fille apprend à compter. A New York, nous habitons au 12e étage. Or il n’y a pas de 13e étage dans les gratte-ciel américains.
J’essaie de lui expliquer qu’une année est composée de 13 pleines lunes, que les femmes sont rouges 13 fois par an, mais que la chrétienté a imposé le chiffre 12 : les 12 apôtres, les 12 mois de l’année... Dans ma chanson, « mère nature » revient avec un stylo écrire le chiffre 13 dans les ascenseurs (rires).
D’où vient la chanson Earth Intruders, qui semble posséder une dimension fantasmagorique ?
Je suis allée en Indonésie, à la demande de l’Unicef, un an après le tsunami. J’ai été marquée par ce voyage. A cause du décalage horaire et de l’appel à la prière, je me réveillais le matin à 5 heures. Je sortais marcher dans les rues. Il y avait encore une odeur de boue et de mort. Des gens creusaient pour retrouver des restes de proches, des vêtements. Dans l’avion du retour vers New York, j’ai rêvé qu’un raz de marée humain balayait mon avion et la Maison Blanche, qu’il prenait le pouvoir et ramenait la justice sur la planète. Une fois en studio avec Timbaland, j’ai sorti le texte d’Earth Intruders comme un tsunami de mots.
Volta est-il un album qui se fait l’écho des tumultes du monde ?
C’est un album plutôt gai. Je me suis rarement sentie aussi heureuse et solide. C’est peut-être pour ça que je parle des autres. Nous vivons une époque mouvementée, quelque chose de bon peut en sortir. Des gens qui ne s’intéressaient pas à la politique s’y intéressent aujourd’hui.
Après le choc du 11 Septembre et celui de la réélection de Bush, beaucoup de problèmes sont revenus à la surface. Aujourd’hui, aux Etats-Unis comme en Europe, on comprend que la guerre en Irak a été une erreur. Le complexe de supériorité des Américains en a pris un coup. Ils redeviennent humains.
Vespertine et Medùlla, vos albums précédents, semblaient plus attirés par l’intellect que par le corps. Volta, est-il plus physique ?
J’ai toujours essayé de raccorder le corps et l’esprit. A l’époque de Medùlla, je venais d’avoir un enfant, je donnais le sein, c’était donc physique, mais très introverti. Aujourd’hui, ma fille a 4 ans et je suis sans doute plus prête à appréhender physiquement le monde extérieur. C’est peut-être une façon de récupérer mon corps. J’ai toujours aimé travailler sur les rythmes. Quand mes copines et moi, à 14 ans, avons formé un groupe, je voulais être batteur.
Les cuivres tiennent une place importante dans cet album. Pourquoi recruter une section de cuivres de dix Islandaises ?
Il y avait déjà pas mal de cuivres dans Drawing Restraint 9 (la bande originale du film de son compagnon, l’artiste de renommée internationale Matthew Barney), mais utilisés de façon plus abstraite. J’ai d’abord composé avec un échantillonneur, puis je suis allée jusqu’à utiliser dix instrumentistes. Nous commencions également à penser à la tournée.
Il semblait évident qu’entre les musiciens, les techniciens, les roadies, il y aurait beaucoup de mecs. J’ai alors décidé de passer une audition, en Islande, uniquement de filles ! Ça a marché. Elles sont géniales !
Avez-vous le sentiment que l’innovation est le carburant de votre création ?
Je suis probablement plus alimentée par l’ennui. J’ai la capacité de concentration d’une adolescente. Parfois, je me dis que je ferais mieux d’enregistrer plusieurs disques avec la même instrumentation, je pourrais mieux progresser, mais je n’ai pas la patience de le faire. Quand je comprends comment marche quelque chose, il me faut passer à un autre projet.
Vous êtes devenue une icône de la musique, de la mode, des arts visuels. Etait-ce l’un de vos buts ?
J’ai toujours eu le désir ardent de m’exprimer. Si j’ai la moindre conscience d’un devoir à accomplir, c’est en tant que femme. Je dois persévérer dans cette mission que la chance m’a donnée et essayer d’atteindre mon plein potentiel. Car, depuis que je suis petite fille, j’ai entendu les histoires de toutes ces femmes incroyablement talentueuses qui n’ont pu s’épanouir pour des milliers de raisons.