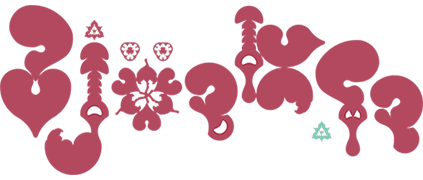Récemment, un quotidien anglais tentait, avec plus d’humour que de médecine, de cerner les symptômes du mal d’époque : le pre-millennium tension, cette dépression sournoise qui attaquerait l’homme à l’aube de chaque millénaire. Un mal dont Tricky a fait l’un des titres d’albums les plus judicieux de cette ère trouble. Parmi les premiers signes de la maladie, on trouvait : “écouter en boucle le nouveau single de The Verve et rêver de partir en vacances. En Islande.” Il faudra donc sérieusement que l’on songe à aller consulter son médecin. Mais avant, on ira en Islande. Ecouter The Verve. Et l’on y découvrira une autre bien curieuse spécialité locale : SAD. Soit : Seasonal Active Disorder (dépression due aux changements de saison). Une dépression qui frappe de plus en plus fort au fur et à mesure que l’on s’approche du pôle Nord. La maladie que les Suédois appellent “vemod” quand il s’agit d’évoquer leur mélancolie poison. Ici, en Islande, entrée dans sa phase suintante.
Il y a une dizaine d’années, malades avant nous, ils étaient venus du monde entier en méchants croquenots de randonnée et en anoraks top-fluo, babas parfaitement modernes conversant sur le Net avec Nicolas Hulot. Comme dans Rencontre du troisième type, ils avaient tous rêvé d’une montagne : Untel en mangeant sa purée de haricots, Untel en lissant le chanvre. Ils ont vu la montagne et ils se sont méchamment gelé les roustons à attendre : l’ovni, qui devait atterrir ce jour-là sur le gigantesque glacier de Snæfellsjökull, n’est jamais venu à la rencontre de ces drôles de types. Sans le savoir, les malheureux ufo-spotters comme on dit trainspotters pour ces vaches qui aiment à regarder et comparer les trains qui passent n’étaient pas passés si loin du but : l’ovni était là, à 200 kilomètres plus au sud. Un ovni avec des couettes, des jupettes et des socquettes. Un ovni au nom martien : Björk Gudmundsdóttir.
Alors brailleuse dans tout ce que l’Islande a à offrir de libertins et de punks à haute teneur arty, Björk est déjà une star à Reykjavik. Célèbre depuis qu’on lui a laissé, à 11 ans, enregistrer un album de comptines locales et révéler sur une chanson un don précoce du songwriting débraillé, Björk ne provoque qu’admiration ou mépris, crises de rire ou méfiance. Avec sa jolie bande d’allumés de Kukl, son groupuscule anar enlevé à l’Islande par les Anglais furieux de Crass Records, à Tappi Tíkarrass , elle est l’ambassadrice d’un mauvais goût élevé au rang d’art majeur. L’un d’eux, Kiddi, qui connaît Björk depuis l’enfance, tient aujourd’hui la boutique Hljomalind, temple de toutes les musiques détraquées du monde, où parfois travaille le frère de Björk. “Depuis que je suis gamin, je connais Björk de vue. On a grandi dans le même quartier, où elle ne passait pas inaperçue, habillée en Indienne ou en trucs incroyables qu’elle se faisait elle-même. J’ai commencé à la fréquenter en 83, notre bande était de toutes les fêtes, elle n’en faisait déjà qu’à sa tête. C’était une vraie fêtarde, ivre d’expériences, souvent à l’origine de redoutables plaisanteries. Ce n’était jamais cruel mais souvent mal perçu, trop surréaliste. Nous étions des gens bizarres, avec un humour bizarre jouant une musique bizarre. Mais elle était la seule à vraiment posséder un talent, ça crevait les yeux.”
Ici, tout le monde possède ainsi un petit souvenir intime de Björk. Soit pour l’avoir vue, Vanessa Paradis avant l’heure, enflammer les charts locaux à l’âge des Barbie. Soit pour avoir vu cette punkette intraitable semer la confusion dans la nuit de Reykjavik la taille d’une sous-préfecture mais la vie nocturne d’une capitale. Marquée à vie, une vendeuse du Virgin Megastore local se souvient l’avoir vue hurler et gesticuler sur scène enceinte jusqu’aux dents de son fils Sindri. “Tout le monde la détestait, jure-t-elle. Et puis soudain, les Sugarcubes ont commencé à avoir un peu de succès à l’étranger et ce que les gens trouvaient jusqu’alors débile et vulgaire est devenu cool et drôle. Six mois avant, on leur fermait les portes au nez pour les mêmes raisons qui faisaient soudain d’eux des artistes.”
On a beau le savoir, il est à chaque fois sidérant de constater comme la culture pousse bien loin de la mode, cette couche de cendreasphyxiante. Que ce soit à Dunedin, Reykjavik ou Brive-la-Gaillarde, la culture est un gilet de sauvetage très résistant à l’hostilité des éléments. On n’a jamais vu autant de disquaires aussi richement approvisionnés qu’en Nouvelle-Zélande ou à Reykjavik deux bouts du monde monstrueusement cultivés, au pouls permanent du globe via tous les moyens de communication disponibles et imaginables, des télévisions satellisées au Net. Aujourd’hui à la pointe technologique quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux du Net viennent de Reykjavik et même du rock local, des Sugarcubes à Gus Gus , l’Islande n’a plus qu’une idée en tête : faire de Reykjavik la capitale européenne de la culture pour l’an 2000.
Dans cette ville au climat pourtant hostile on a vu, au mois d’août, des voitures rouler en pneus cloutés , la jeunesse lutte contre le désoeuvrement, contre ces circuits provinciaux qui vont du McDo au disquaire, avant de se taper la tête contre les murs de l’ennui. Ici, elle se rebiffe voir l’activisme forcené des membres de Gus Gus, impliqués dans le théâtre, les communications, la danse, le cinéma, les musiques, la littérature, la politique, les clubs, la vidéo, la peinture et Reykjavik ne sera jamais Vierzon ou Little Rock, une ville morte, morne. On comprend la passion de Jarvis Cocker ou de Damon Albarn qui a investi dans un appartement et un café de la ville pour cette cité mollusque, aux contours flous, aux regards encore plus flous dès que tombe la nuit sur l’alcoolisme libéré.
Comme dirait Diabologum, “L’art est dans la rue.” La rue en question s’appelle Laugavegur, la principale artère commerciale de la ville. Des libraires, des galeries et des disquaires y jouent à touche-touche. Pas moyen d’échapper à la drum’n’bass, qui dégueule joyeusement de boutiques à la spécialisation insensée : Untel ne vendant que de la jungle, un autre uniquement du trip-hop, un troisième n’affichant en vitrine que de la house française. Une seule constante dans chaque boutique : l’impressionnant présentoir Björk. Il est comique de voir la récupération outrancière de Björk par la redoutable machine à tourisme islandaise. Une Björk convoquée, entre un glacier et une baleine, sur chaque guide local. Si vous feuilletez aujourd’hui un dépliant touristique sur l’Islande, vous ne lui échapperez pas, ambassadrice à son corps défendant d’un pays qui l’avait pourtant mise hors jeu. Boudeuse, elle tourna ainsi longuement le dos à l’Islande, ses deux premiers albums solo reflétant parfaitement son évasion vers l’Angleterre.
Debut et Post nous faisaient ainsi visiter le London by night vu à travers les lunettes multicolores de Björk. Elle nous présentait ses amis DJ’s fêlés, ses spécialités : le saut périlleux sur le dance-floor, les comptines perverses de l’aurore, les moments violemment heureux comme ceux Oh, si terriblement paisibles. Deux magnifiques plantes, mais sans racines : impossible d’entrapercevoir l’Islande à travers tous ces voilages, ces brouillards. Deux disques expatriés, gourmands de découvertes, ivres des possibilités offertes. Une fiesta qui aurait dû s’achever en pente douce, mais à laquelle un fan américain a collé une fin brutale : en envoyant à Björk un colis piégé après avoir filmé son propre suicide il ne supportait pas que son idole vive avec un Noir , il brisa violemment la bulle londonienne de l’Islandaise. Soudain rattrapée par la réalité, comme on se réveille en sursaut d’un rêve bleu et rose, Björk se frotta méchamment les yeux. “Des moments terribles, qui m’ont pourtant permis de me retrouver, de me ramener à la réalité de ce monde. J’ai compris qu’il fallait faire un peu de ménage dans ma vie”, commentera-t-elle.
Sa carrière solo, jusque-là spectaculaire et audacieuse comédie musicale, vire alors au film d’auteur. Et prend de la hauteur. Car Björk, affolée, est revenue au cocon, à la maison. Dans un immense appartement qui surplombe les chantiers navals de Reykjavik, elle s’est repliée, fuyant un music-business qui faillit, l’an passé, lui faire jeter l’éponge. Au lieu de regarder les trains passer spécialité de la musique anglaise , elle préfère désormais la compagnie des bateaux. “C’est comme ça que je m’en suis sortie : je vois des vieux rafiots délabrés arriver sur les chantiers navals et quelques semaines après, ils reprennent la mer flambant neufs. C’est la meilleure thérapie que j’aie jamais suivie.”
Homogenic, son troisième album solo, sera donc son album islandais. Et il suffit de quelques jours seulement à sillonner les routes estomaquantes entre Laugarvatn et Fludír pour en être convaincu : tout ce que l’on voit, on l’entend enfin chez elle. Les fascinantes plaines de lave, les fracas de roches, les glaciers aux formes cocasses, la pierre fêlée, la beauté givrée et les geysers, ces orgasmes de la terre, toute l’intimidante nature en mouvement de l’Islande est là, nichée dans les tréfonds du magnifique Joga, dans les abysses du fascinant Hunter, dans les sommets glacés de Bachelorette. Même enregistré en Espagne, Homogenic sera donc l’album country de Björk country comme dans countryside. Soit un disque paysagiste, comme chez Palace. Paysage : accidenté, faussement apaisé, encore en chantier, où l’homme n’est qu’à peine admis, à peine le bienvenu. Dieu n’aime pas qu’on entre dans son bureau quand il est encore au boulot et il n’a jamais eu le temps de finir l’Islande. Car ici, en Islande ou dans Homogenic, on sent la lave à quelques centimètres seulement sous ses pieds, prête à tout emporter, ne demandant qu’à exploser, à jaillir. Jamais calme de surface n’a été aussi menacé, instable, inquiétant. Jamais s’est-on senti aussi humble face à la nature. En accord avec Nick Hornby, grand gourou de la secte des incurables fabricants de Top 5, on a ici traversé deux des lieux au monde où la musique était le plus en accord avec le paysage. Deux de nos expériences musicales les plus vibrantes : écouter Björk sur la route de Pingvellir, succomber à Tortoise en plein désert de Grindavík. Ces fameux “emotional landscapes” qu’elle hurle dans Joga.
Homogenic sera également l’album folk de Björk, un folk loin de celui qu’elle subissait, enfant, dans la communauté hippie de maman un authentique personnage, maman : connue comme le loup blanc à Reykjavik, elle ferait apparemment passer sa fille pour une sainte nitouche. Non, un folk beaucoup plus dada que baba, un folk folâtre, un folk défroqué, possédé. Car derrière l’épure vraiment magnifique d’Homogenic, pas une seconde de répit, d’affaissement, de démission. Pas demain que Björk signera l’armistice avec la facilité. Intransigeant, plein et habité comme jamais chez elle, Homogenic est aussi de très loin son album le plus personnel. Un disque lunatique et lunaire. D’ailleurs, on sait désormais où la NASA, aimable farceur, a filmé ses chouettes clips, Le Lem glandouille sur la Lune, puis Pathfinder n’en branle pas une sur Mars : dans la mer de lave parfaitement désertique et extraterrestre de Kleifarvatn, où l’on fit quelques petits pas pour soi-même, égoïste, en se fichant pas mal de l’humanité. Et où l’on se félicita la lave rend philosophe, on le sait depuis qu’on a vu Tazieff proclamer “L’Etna, c’est moi” d’avoir eu la prudence de se tenir toujours éloigné d’un instrument de musique. Comment, en effet, prétendre apporter du neuf derrière Homogenic ? On plaint sincèrement les musiciens qui vont se prendre une telle leçon d’humilité en plein dans le solfège.
Mais s’il y a beaucoup de nature islandaise dans Homogenic, il y a aussi beaucoup de Reykjavik dans ses couleurs délavées, dans son besoin de cocooning, dans sa lumière embuée. C’est là, sur le port, que l’on rencontre Björk. Sur l’un de ces quais mythiques où, jadis, le capitaine Haddock retrouva son vieux complice Chester en route pour L’Etoile mystérieuse. Des vieux loups de mer, il y en a beaucoup au Kaffi Vagnínn, où Björk possède ses habitudes. A 5 h du matin, c’est dans ce café, autour des tables en formica, que se croisent les marins pas pressés d’affronter l’hostilité de la mer et les night-clubbers pas vraiment impatients de retrouver leur lit. Fatiguée, vieillie par presque deux années de service après-vente de son dernier album Post, Björk nous accueille par un strident “C’est la guerre, il faut repartir au combat.” Furieuse d’être tuée à la tâche par son marchand de disques, elle a décidé de se barricader. Et jure qu’ici, à Reykjavik où elle vit désormais, elle saura se défendre contre les envahisseurs. Les ancêtres de Björk ignoraient la peur, ignoraient le Seasonal Active Disorder. Ils étaient vikings.
A une époque, ton nouvel album devait s’appeler Dare “oser”. Est-ce une philosophie de vie ?
Björk C’est le premier album où je prends de vrais risques, où j’ai cherché l’affrontement. Il fallait en passer par là. Aujourd’hui, les chansons que j’écris sont apaisées. Mais pendant l’enregistrement d’Homogenic, j’avais envie de pousser les gens à bout. J’ai perdu patience, j’en avais assez de gâcher autant de mon énergie à lutter contre la pression du business. Je me suis retrouvée à un croisement. Et j’ai choisi une route sur laquelle tout le monde n’allait pas pouvoir me suivre. C’est un nouveau départ car c’est mon premier véritable album solo. Jusqu’à présent, je m’étais beaucoup amusée. Enregistrer deux disques comme Debut et Post, c’était un rêve devenu réalité. J’avais ces deux disques en moi depuis que j’étais enfant. Capturer en plus l’attention des gens était un bonus inespéré. Mais au fond de moi, cette vieille voix me disait de pousser, comme à l’époque où je vivais encore en Islande, les choses à l’extrême. C’est mon caractère.
As-tu trop pris en compte l’avis des autres sur ces deux premiers albums solo, par manque de confiance ?
Au moment de Debut, j’avais le disque en moi, mais je ne savais pas comment l’expliquer aux gens. Je ne savais pas parler à un ingénieur du son, j’étais incapable de m’accrocher fermement à mes idées, j’ai souvent cédé face aux requêtes des uns et des autres. Aujourd’hui, on ne peut plus me bluffer, je sais expliquer exactement ce que je recherche et refuse de reculer. J’avais beaucoup de mal à m’imposer comme le boss. D’ailleurs, je ne me considère toujours pas comme le patron. Je suis seulement celle qui possède la carte et le sextant. Je sais où l’on va et mon but, en tant que navigateur, est d’expliquer le voyage à chacun. Quand on enregistre avec moi, désormais, on suit mon itinéraire.
Passer de l’anarchie de Kukl au contrôle strict d’Homogenic te pose-t-il des problèmes de conscience ?
Les disques qui m’ont le plus bouleversée dans ma vie ont toujours été têtus, ne reflétant qu’un seul et unique point de vue. J’aime cette clarté. Mais pour ça, il me fallait apprendre. Et j’apprends lentement. Il ne faut pas oublier que j’ai commencé à enregistrer à 11 ans et que depuis, barreau après barreau, prudemment, j’ai grimpé l’échelle. D’abord en apprenant à chanter, puis à écrire les paroles, puis à jouer des claviers, puis à arranger les cordes… Avec les Sugarcubes, j’étais encore stagiaire, j’observais. J’ai toujours fait très attention à avoir, devant moi, exactement autant de territoires inconnus que j’ai, derrière moi, de territoires déjà visités. L’inconnu, ça me permet de conserver une innocence, d’avoir encore des choses à apprendre, des situations à découvrir. Mais tout ce que j’ai déjà vécu, je l’emporte avec moi dans mes bagages. Par exemple, le travail effectué par Nellee Hopper sur Debut m’a permis de coproduire avec lui, Tricky ou Howie B quelques-unes des chansons de Post. Ainsi, j’avance, j’abats les obstacles. Désormais, je peux travailler seule sur les beats, régler des arrangements comme ceux de Bachelorette. Ça m’a permis de coproduire Homogenic avec Mark Bell, de LFO. Quand Eumir Deodato est venu orchestrer quelques chansons avec l’Icelandic String Octet, je n’en ai pas perdu une miette, car cet homme a enregistré environ quatre cents disques dans sa vie. Je regardais comment il positionnait les micros, les musiciens, comment il dirigeait son orchestre. Je sentais une vraie responsabilité dans sa baguette : sans lui, sans ce phare, l’orchestre se serait perdu. Voilà, encore une leçon bien apprise. Peut-être ferai-je le prochain album toute seule. Mais ça n’a rien à voir avec une obsession du contrôle : c’est juste une soif d’apprendre, de me mettre en danger. La lâcheté est ce qui me fait le plus peur. Comme un explorateur, j’aime profiter des terres que j’ai découvertes, mais ça ne m’empêche pas d’aller en chercher d’autres.
Etait-ce vital de travailler avec un chef d’orchestre et un ensemble à cordes islandais ?
L’idée était de faire une musique qui se fonde dans le paysage islandais, une musique à cordes typiquement islandaise. Ce qui est une gageure, car une telle chose n’existe pas : il n’y a pas de musique islandaise, elle est sous influence étrangère. L’identité islandaise, on la trouve dans la littérature. Mais là, dans un studio espagnol, ensemble, nous avons tenté de créer une musique islandaise. Parfois, Deodato me laissait diriger l’orchestre, c’était magique. Quand il me sentait en difficulté, il rattrapait la baguette. A chaque fois que je les entendais jouer, je pleurais. Mes rêves les plus ambitieux devenaient, sous mes yeux, une réalité. Souvent, je me demande pourquoi j’aime autant les cordes peut-être représentent-elles le système nerveux de la musique. Je suis certaine que ces cordes de boyaux font vibrer les nerfs, qu’elles les font fondre. Voilà pourquoi les cordes sont tellement utilisées dans les musiques de film. Ma théorie, pour Homogenic, était de faire un disque d’anatomie : le système nerveux est représenté par les violons ; les poumons et l’oxygène par la voix ; le coeur par le rythme.
C’est pourquoi il est si nu, à même la peau ?
Sur Post, j’ai utilisé trop d’instruments, j’étais comme une gamine lâchée dans un magasin de jouets. Mais c’est trop facile d’amuser les gens pendant trente-cinq minutes quand on a un tel arsenal de jouets à sa disposition. Le vrai défi est de maintenir l’attention avec trois fois rien. C’est pourquoi je n’ai gardé que les trois bruits essentiels, les trois bruits qui existent depuis la nuit des temps les plus forts. La respiration, le coeur qui bat et les nerfs qui frémissent. Au début de l’enregistrement, j’avais décidé qu’il n’y aurait pas une ligne de basse. Je voulais jouer avec la stéréo : mettre la voix au milieu, les violons d’un côté et les beats de l’autre, pour que l’auditeur décide ce qu’il avait envie d’entendre.
Ta peur de passer pour une lâche est-elle un trait particulièrement islandais ?
Ça vient du désir profond d’être autarcique, de ne rien devoir à personne. Il y a quelques années, les Nations unies ont commandité une enquête à l’échelle mondiale sur les caractères propres à chaque nation… Les conclusions étaient inquiétantes pour la santé mentale des Islandais. A la question “Etes-vous heureux ?”, tous ont répondu férocement “Ouuuuuiiiii.” “En quoi croyez-vous ? En moi, uniquement.” Les autres pays ont répondu Allah, Bouddha, Jésus. Mais pas les Islandais. Ici, quand notre voiture est en panne, on la répare nous-mêmes. Quand on a envie d’une jolie robe, on la confectionne soi-même. Quand on a envie d’entendre une pop-song, on l’écrit soi-même. Ce n’est pas un goût du risque : c’est juste que l’on sait que personne ne viendra nous prendre par la main. C’est pour ça qu’il y a tant d’artistes en Islande. L’art n’est pas réservé à quelques heureux élus, placés sur un piédestal. Par exemple, mon grand-père fabrique des cheminées. Quand on se voit, il apporte toujours des photos de ses dernières créations ; en échange, je lui fais écouter mes chansons. Ça nous met immédiatement sur un pied d’égalité. Ma grand-mère peint, elle part parfois plusieurs semaines toute seule dans les plaines de lave, ma mère est férue d’homéopathie et enseigne l’haïkido aux enfants qu’importe le métier, le principal est d’acheter son indépendance.
Comment vivais-tu, plus jeune, le fait d’habiter si loin de tout ?
Ça n’a jamais été un problème car nous, Islandais, avons toujours été obsédés par l’information. Si bien que nous savons en direct ce qui se passe partout ailleurs. Pendant des siècles, les souverains de Scandinavie et d’Allemagne venaient en Islande pour apprendre leur propre histoire car depuis des centaines d’années, nous avions consigné toutes les informations dans de vastes sagas. Les Sagas royales, La Saga de Njáll le Brûlé, La Saga des chevaliers toutes ont été écrites ici, aux XIIIème et XIVème siècles. Car notre spécialité, c’est de raconter les histoires (le mot “saga” vient de l’islandais “segja” : “dire, raconter”). Au Moyen Age, on mémorisait toutes ces histoires grâce aux rimes, c’était autant de la prose que des chansons. Les histoires passaient de père en fils. Certaines d’entre elles duraient trois heures, mais les Islandais les apprenaient par coeur c’est ainsi qu’elles ont survécu, se sont transmises. Ensuite, on les a écrites. Ainsi, la pop-music, en Islande, est assez proche de la tradition française des chanteurs : on y raconte des petites histoires. C’est beaucoup plus proche de Gainsbourg ou de Brel que de l’école anglaise. On n’entend quasiment pas la musique, les voix sont incroyablement en avant. Il ne faut pas oublier que, jusqu’en 1944, nous avons été une colonie danoise, lourdement taxée. Nous étions jusqu’alors très pauvres… Je me souviens avoir vu mon grand-père habiter dans une cabane aux murs de torchis, comme au Moyen Age… Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes enrichis grâce à la pêche et aujourd’hui, nous sommes parmi les pays les plus riches du monde. Car là, en 1944, nous avons avancé de quatre siècles d’un coup. L’art de raconter les histoires aurait pu se perdre, mais il a su s’adapter. On est passés directement des veillées familiales au traitement de texte sur ordinateur. Mais les histoires ont survécu. La première fois que l’on m’a parlé d’Internet, j’ai su que c’était pour l’Islande. Tout le monde ici s’en sert, certains Islandais ont même fait fortune grâce à ça. Quand j’étais gamine, nous n’avions même pas la télévision. Mon fils Sindri, lui, me donne des cours d’informatique. Mais même lorsque nous étions pauvres, nous savions tout ce qui se passait dans le monde, car les histoires circulaient, c’est une obsession.
Savoir ce qui se passe dans le monde sans en être vraiment acteur te rend-il cynique ?
Quand j’ai débarqué en Angleterre, j’ai été estomaquée par le cynisme des gens, ça me rendait folle de rage de les voir tout critiquer à ce point. Nous avons, nous, une véritable mentalité d’insulaires : nous vivons dans un endroit magnifique et pur, et pourtant, notre obsession est de partir. On veut partir, mais on ne peut pas vivre ailleurs : voilà notre dilemme. Toute ma vie, je sais que je vais aller et venir, être frustrée de vivre ici puis être en manque d’Islande. Et pourtant, Dieu sait si j’ai eu, ici, l’impression d’être prise au piège, coincée par les mers. A l’époque des Sugarcubes, l’équilibre était idéal : nous vivions tous ici, mais passions six mois par an à tourner dans le monde entier. Adolescente, déjà, je partais trois fois par an à l’étranger. C’est le sang viking en moi : il faut toujours partir, ne jamais s’encroûter. Les vikings n’étaient pas sédentaires, ne savaient pas se contenter d’une île, préféraient risquer l’aventure dans l’Atlantique sur de frêles bateaux de bois. C’est un trait de caractère que je retrouve chez tous les véritables insulaires. Par exemple, les Jamaïcains ne considèrent pas les Islandais comme des Blancs. Ma meilleure copine était un jour dans un club et un grand Noir est venu à sa rencontre et lui a dit “Je le sais, tu viens d’une île.” Moi-même, j’ai beaucoup d’amis à Hawaii, en Sicile, à Chypre. Je suis fière de mon pays mais je n’y vis jamais. J’adore cette contradiction, c’est stimulant. Mon fils n’arrête pas de me le dire : “Maman, il te manque toujours quelque chose pour être heureuse.” Cette insatisfaction est très romantique, elle me pousse en avant.
Il y a un an, tu échappais à un attentat assez pervers. Loin des tiens, t’es-tu soudain sentie vulnérable ?
Quand je suis partie vivre en Angleterre, je savais que ce serait temporaire, le temps de mener à bien une mission. Elle seule pouvait me faire quitter l’Islande, avec mon fils et mes valises. Et pendant quelques années, j’ai retenu ma respiration. Pourtant, j’adore l’Angleterre : j’y suis arrivée comme une immigrée et regarde ce qui m’est arrivé… C’était excitant, drôle, passionnant, mais il fallait que je respire à nouveau. Je sentais que si je restais, il n’y aurait plus de danger, plus de défi. J’allais sombrer dans la colère ou la dépression, qui sont chez moi les deux seules réponses au désoeuvrement, à l’absence de combat. Il fallait donc changer de route pour que moi, je me retrouve au même endroit : ce lieu fertile où me vient l’inspiration. Mon arbre généalogique remonte sur 1 200 ans et on n’y trouve que des Islandais. Pas un étranger n’est venu changer le cours des choses. Je suis donc l’héritière de 1 200 ans de gènes insulaires, qui me disent de me battre contre des ennemis largement plus grands que moi. Ce colis piégé, la mort de ce fan, ça a été un choc terrible. Mais ça n’a été que la partie visible de l’iceberg, un symbole de tout ce qui clochait alors dans ma vie privée. Mais je ne voyais rien ou je refusais de voir. Cet accident m’a juste ouvert les yeux. Depuis des années, je jouais les prolongations, je testais la résistance de l’élastique qui me retient à l’Islande. Et là, avant qu’il ne claque, je suis rentrée.
Te sens-tu moins casse-cou qu’il y a dix ans ?
Je vais d’un extrême à l’autre. Je peux être terriblement tatillonne et domestique, cuisiner et bricoler pendant des heures. Et ensuite, je prends des risques inconsidérés aussi bien dans ma vie sentimentale que dans des domaines plus terre à terre. J’ai besoin, chaque jour, de me tester, de me prouver que je suis toujours en vie. Car jusqu’à l’âge de 27 ans, j’ai vécu entourée de près par une famille incroyablement attentionnée et très soudée. Par exemple, lorsque j’organise une soirée d’anniversaire pour mon fils, le strict minimum de gens de ma famille invités est de cent personnes. Ce sont mes intimes. J’aime pouvoir me reposer sur cette sécurité et, en même temps, j’adore sauter du haut d’une falaise dans la mer. C’est pour ça que je respecte tant les choix de mon fils, car je sais qu’il n’y a pas une façon de vivre et je fais confiance en son instinct. Depuis qu’il est petit, je lui ai toujours laissé le libre arbitre : il mange ce dont il a envie, porte les vêtements qui le tentent. Lui et moi, nous sommes le jour et la nuit : il est très calme en public et surexcité à la maison exactement à l’opposé de moi. Il est la seule personne qui m’ait supportée si longtemps, qui soit capable de vivre avec moi onze années d’affilée. C’est peut-être la seule solution pour quelqu’un dans ma position : avoir un fils plutôt qu’un copain (rires)…
Comment te sens-tu dans le rôle imposé d’ambassadrice d’Islande ?
Ça n’a jamais été de mon plein gré. On m’a proposé de faire de la pub pour des produits de la mer, d’être diplomate, d’entrer dans un parti politique et j’ai toujours refusé. J’espère que Gus Gus aura du succès et que mon heure passera. Car il y a beaucoup de talents ici que j’éclipse. Le plus drôle, c’est d’être à ce point récupérée par les officiels de l’art… Récemment, j’ai obtenu le prix Nobel de musique, une distinction réservée aux artistes scandinaves c’est la première fois qu’il était remis à quelqu’un ne venant pas de la musique classique. Ce fut un moment historique pour l’Islande. Et hystérique pour moi (rires)… Quand je me suis rendue à Oslo pour la remise du prix, tous les politiciens de mon pays étaient là, encore plus fiers que moi. Mon père, qui est le leader du syndicat des électriciens d’Islande, est venu aussi. Quand nous avons débarqué à l’aéroport, l’ambassadeur d’Islande en Norvège est venu nous accueillir en grande pompe. C’est un ancien leader conservateur contre lequel mon père s’était farouchement battu en tant que représentant des ouvriers du bâtiment. Et il a porté lui-même les valises de mon père (sourire fier)… A cette époque, une grève géante était sur le point d’exploser en Islande, la plus grosse de l’histoire. Mon père était sans cesse à la télé, à hurler contre l’Etat dans ses mots à lui, à prendre la défense des ouvriers et le gouvernement a profité de son absence du pays pour signer un deal totalement injuste avec les syndicats. A la cérémonie, tous ces politiciens ont fait des discours à mon honneur : “Björk a sauvé l’honneur de notre pays, bla-bla-bla.” C’était les mêmes qui, à l’époque des Sugarcubes, nous mettaient des bâtons dans les roues, refusaient de nous aider à monter des structures tout en versant d’énormes subventions aux fédérations de jeux d’échecs. Nous, on était les canards boiteux, et là, ils levaient leurs verres de champagne en mon honneur. Mon père a pris le micro et s’est lancé dans un long discours et a dénoncé toute l’absurdité de la situation.
Comment expliques-tu que la bande d’adolescents turbulents dont tu faisais partie ait à ce point réussi à s’imposer dans le milieu de l’art et de la communication ?
A chaque fois que je rentre au pays et que j’ouvre le journal, je reconnais les têtes de ceux qui, aujourd’hui, sont en position de force ici. A l’époque où nous nous sommes tous rencontrés, l’Islande était à un carrefour. Pour la première fois, une génération débarquait et osait penser “Peut-être valons-nous aussi bien que les autres populations du monde.” L’Islande était enfin sortie de la misère, beaucoup d’argent était dépensé en éducation et en santé. Mais rien pour la culture. La culture islandaise se limitait alors à la littérature. Il n’y avait aucune musique locale, que de vagues copies de modèles anglais. Pour nous, le punk n’était pas, comme en Angleterre, une rébellion contre les valeurs monarchiques, contre l’autorité. C’était une rébellion contre un complexe d’infériorité. L’idée était la suivante : “Vous pouvez le faire vous-même, et en plus, le faire en islandais.” A l’époque, il y avait du boulot pour tout le monde, trop de boulots disponibles même. C’était la course aux plus belles voitures, aux plus beaux canapés en cuir, aux plus belles maisons de campagne. Beaucoup de gens travaillaient jour et nuit, car l’argent coulait à flot. Et nous voyions nos parents s’enrichir mais perdre toute vie privée, toute capacité à communiquer. Ils étaient obsédés par le travail, par les bienfaits du monde matérialiste car depuis mille ans, ils en avaient été privés. Et nous, nous avons refusé d’aller au travail, nous étions les “antis”. Antimatérialisme, anti-impérialisme…
As-tu souffert d’être connue ici, d’être privée d’anonymat ?
C’est une ville tellement petite que nous étions très connus. Mais l’avantage de l’Islande, c’est que le culte de la personnalité n’existe pas, on nous laissait tranquilles les journaux, par exemple, n’ont pas de rubrique “potins”. Même aujourd’hui, personne ne me demande ici d’autographes alors que tout le monde sait où j’habite : à quoi bon demander un autographe à quelqu’un que tu as vu, quelques heures avant, acheter du papier-toilette au supermarché ? J’ai peur que tout ça ne change avec l’avènement de MTV. La dernière fois que j’ai débarqué en Islande, le chauffeur de taxi m’a engueulée. “Alors maintenant que tu as du succès, tu te crois plus importante que tout le monde, hein ? Pardon ? Oui, j’ai vu ta grand-mère à la piscine l’autre jour et elle m’a dit que tu ne lui avais même pas téléphoné le jour de son anniversaire !” Ici, on ne m’autorisera pas à prendre la grosse tête, à devenir une star.
La relation des Islandais à la nature est très forte, presque mystique. Qu’en est-il pour toi ?
Depuis qu’il existe des émissions et des films comme les X-files ou Ghostbusters, les gens commencent à se dire que, parfois, il existe dans la nature des forces qui les dépassent peut-être. En Islande, on sait que nous sommes dépassés par la nature. Ici, la nature tue régulièrement les marins, les montagnards. On sait qu’elle est la plus forte et on n’en fait pas une montagne. Ce port, je le sais, est plein de fantômes. Et alors ? On ne va pas épiloguer. C’est un fait, ça fait partie de ma vie quotidienne, je sais que certaines montagnes me transforment lorsque je leur rends visite. C’est une relation très terre à terre, pas du tout mystique ou surnaturelle. Je sais qu’une semaine dans les montagnes va me requinquer. Mais je sais aussi que je ne vais pas y trouver des petits elfes qui vont venir recharger mon corps de leur énergie en dansant (rires)…
Ressens-tu parfois l’hostilité de la nature ?
Je l’ai ressentie de façon très violente il y a une semaine. J’étais en train d’être filmée par hélicoptère sur un glacier et soudain, j’ai senti que la montagne m’écrasait de sa présence, de sa dignité. Elle était désolée un mot qui décrit bien l’Islande et, en même temps, suprêmement belle. Comme le reste du pays, elle ne faisait pas d’effort de maquillage pour séduire, elle était brute, nue : elle était d’autant plus impressionnante. Quand je regarde les Alpes, je les trouve trop bien dessinées, comme si on avait confié leur réalisation à Walt Disney. Je m’attends sans arrêt à voir Bambi surgir d’un chemin. Là, sur le glacier, je me suis soudain sentie idiote et vaniteuse. A chaque fois que ça m’arrive, c’est un soulagement. “Merci de me prévenir, de me remettre à ma place.” Quand j’ai vécu le dernier tremblement de terre, à Los Angeles, ma première réaction a été de remercier la Terre. Car c’est la première fois que ma terre d’Islande venait me rattraper ailleurs dans le monde, qu’elle venait me donner une leçon d’humilité à l’étranger. Il est bon de se faire rappeler, parfois, que l’on n’est rien.