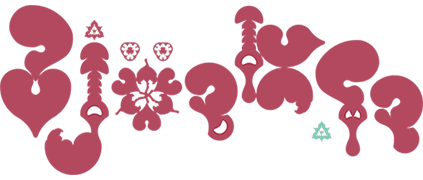« Vulnicura » est inspiré par votre rupture amoureuse. Jusqu’à présent, vous parliez très peu de votre vie privée. Pourquoi avoir choisi de lever le voile sur cette intimité ?
J’ai commencé à travailler sur cet album quand j’ai fini la tournée de Biophilia. Je me suis enfermée et j’ai commencé à écrire des chansons, sans savoir à quoi cela allait me mener. Puis je me suis demandé comment les présenter musicalement, avec quels arrangements. Et ce n’est qu’à ce moment que je me suis dit : « OK, c’est ma propre histoire. » Pour moi, c’était comme dans les films en noir et blanc d’Ingmar Bergman, dans lesquels les personnages sont submergés de conversations psychologiques dans leur tête.
La souffrance est-elle la meilleure source d’inspiration ?
Non, je ne pense pas. La dernière fois que j’ai écrit sur le doute, c’était il y a une quinzaine d’années. Entre-temps, j’ai fait beaucoup d’albums, qui racontent le bonheur, la fête, l’humour, beaucoup d’autres choses positives. Je pense que c’est plutôt un bon rythme de ne parler de sa souffrance que tous les quinze ans.
Quelle est la part de « cura », de guérison, dans cet album ? Est-ce que vous vous sentez plus forte aujourd’hui ?
Toutes les chansons datent d’il y a deux ou trois ans. Beaucoup de gens vous disent que le temps permet de soigner les blessures. Sur le moment, on se dit : « Mon œil. » Mais en fait c’est vrai, ça marche. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui.
Votre album a été piraté en janvier, ce qui vous a obligé à anticiper sa sortie. Quelle a été votre réaction ?
C’était difficile d’attendre deux ou trois mois : la seule chose que nous avions à faire, c’était de sortir l’album. D’une certaine façon, j’ai eu de la chance, parce que l’album était déjà mastérisé quand la fuite a eu lieu.
Mais, désormais, avec Internet, nous devons être capables de nous adapter. Nous avons eu quinze ans pour nous y préparer. Pourtant, il y a encore parfois dans l’industrie du disque beaucoup de bureaucratie et des infrastructures préhistoriques. J’aimerais que le système soit plus réactif. Quand un musicien a terminé son album, il a juste envie de le partager et les gens veulent juste l’écouter.
La rétrospective que vous consacre actuellement le MoMA a été un projet de longue haleine. Il paraît que le conservateur du musée, Klaus Biesenbach, vous avait contactée dès 2000 à propos de cette idée.
Je ne me souviens pas que cela remonte si loin. C’était peut-être une plaisanterie de sa part. Il a commencé à m’en parler concrètement il y a environ cinq ans. Puis, deux ans plus tard, j’ai évoqué le sujet avec mon ami Antony Hegarty, qui m’a encouragée. Le problème est que les musées ne s’intéressent pas beaucoup au son et, quand ils le font, c’est avec des enceintes de mauvaise qualité.
A l’inverse, je vais dans des festivals où il y a des enceintes incroyables, les meilleures du monde, hautes comme des gratte-ciel et, en même temps, il y a des images en arrière-plan avec des définitions très imprécises. Le visuel passe au second plan, pour laisser la musique au premier plan. Mais très vite les choses ont été claires avec Klaus Biesenbach : si l’on se lançait dans ce projet, il fallait avant tout privilégier le son. La question était de savoir comment accrocher la musique aux murs.
Vous avez sorti votre premier album à 12 ans. Vous en avez aujourd’hui 49. Combien de Björk se sont succédé au cours de votre carrière ? Ou bien avez-vous le sentiment d’avoir toujours été la même ?
[Sourire.] Je crois que les deux hypothèses sont exactes. Pour chacun de nous, plusieurs existences se succèdent comme enfant, comme amante ou comme mère. Et de nouveaux rôles m’attendent lorsque je serai vieille. Mais ce n’est pas parce que l’on change qu’on ment. Les personnages que je joue dans mon travail sont plus des outils pour incarner ces différentes phases du cours de la vie, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, il y a une continuité.